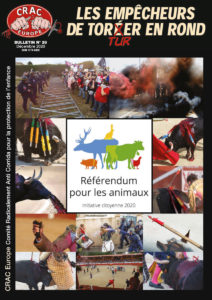Analyse de la corrida
Jean-Baptiste Jeangène Vilmer est philosophe, politologue et juriste français, auteur de Éthique animale (PUF, 2008)._
Tout est dit dans la loi. La corrida est en France une exception à l’interdiction de pratiquer des « sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux » (art. 521 du code pénal). Elle est donc, de fait, reconnue par le législateur lui-même comme un sévice grave ou un acte de cruauté, mais qui, à la différence des autres, n’est pas puni.
Pourquoi cette impunité ? Parce qu’elle a lieu là où « une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ». Voilà donc une pratique punie à Brest, au nom de la sensibilité de l’animal, mais permise à Nîmes, malgré la sensibilité de l’animal. Cette aberration est fondée sur l’appel à la tradition, qui est un sophisme connu depuis 2 000 ans sous le nom d’argumentum ad antiquitam. L’excision est également un rite millénaire, une pratique culturelle, une tradition profondément ancrée. Pourtant, le même législateur l’interdit et fustige ce relativisme culturel, qu’il invoque au contraire quand il s’agit de protéger le « patrimoine » national, dans le cas de la corrida comme dans celui du foie gras. Ce n’est pas parce que l’on fait quelque chose depuis longtemps au même endroit qu’on a raison de le faire. Tous les progrès sociaux ont eu lieu contre les traditions, de l’abolition de l’esclavage au droit de vote des femmes. La tradition en elle-même explique mais ne justifie rien.
Les aficionados d’aujourd’hui invoquent alors leurs illustres prédécesseurs : Francis Wolff cite inlassablement Mérimée, Bataille, Picasso et d’autres. « Se pourrait-il qu’ils ne fussent que des pervers assoiffés de sang ? » (le Figaro, 15 août 2010). Non, bien sûr, mais il y a là deux sophismes. Le premier est l’appel à l’autorité (argumentum ad verecundiam), puisqu’au lieu de produire un raisonnement, on s’en remet à des noms dont l’exemple devrait suffire. Le second est le sophisme « de la bonne compagnie », puisque l’on fait référence non seulement à de grandes personnalités (autorité), mais encore à des gens dotés d’un ethos respectable, d’une image positive, donc insoupçonnables d’être associés à de mauvaises pratiques.
Le raisonnement sous-jacent est celui-ci : Mérimée, Bataille et Picasso sont des gens biens. Or, ils aiment la corrida. Donc, la corrida est bonne. Sophisme, bien entendu, puisqu’il n’y a aucun lien logique entre la sympathie que peut susciter une personne et la légitimité des pratiques qu’elle apprécie. Les personnes citées sont bonnes pour écrire ou peindre, pas forcément pour avoir des jugements éthiques valables.
Qu’une pratique soit une inspiration pour l’art n’en fait pas forcément une bonne pratique. L’art s’inspire de tout, y compris du pire, et heureusement qu’il a cette liberté.
De la même manière, on rappelle souvent que les aficionados sont des gens bien intentionnés. Wolff observe que « nul ne va à une corrida pour voir souffrir un animal ». C’est un sophisme « de la bonne intention ». Que le but de la corrida ne soit pas de faire souffrir n’implique aucunement qu’elle ne fasse pas souffrir. La moralité d’une action ne se juge pas à l’aune des intentions des acteurs. De bonnes intentions ne garantissent pas de bons résultats et, réciproquement, de mauvaises intentions n’excluent pas de bons résultats.
Pour mieux dissimuler cette absence de fondement logique, Francis Wolff et d’autres, comme Alain Renaut, développent une « philosophie de la corrida » qui célèbre le combat de l’homme contre la nature, « l’audace de défier un fauve pour la grandeur du geste », etc. C’est en réalité très simpliste. D’une part, parce que si tout ce que montre la corrida est ce vieux dualisme entre nature et culture que tous les philosophes depuis Descartes ont dépassé, alors elle décrit un monde et un système de pensée qui ne sont plus les nôtres depuis trois siècles. D’autre part, parce que le taureau « de combat » n’est pas un être naturel, mais un produit extrêmement calibré, contrôlé, maîtrisé, un chef-d’œuvre de l’élevage, donc de la culture.
Mais ce qui frappe le plus dans cette littérature est que les qualités attribuées au taureau sont évidemment humaines. Ce n’est pas le taureau qui voit ce que les hommes appellent un combat comme un « combat ». Ce n’est pas lui qui fait preuve de noblesse dans un coup de corne, d’héroïsme ou de bravoure lorsqu’il continue de se défendre tout en se vidant de son sang. Ce sont les hommes qui lui attribuent ces qualités humaines, pour rendre la comparaison possible. La philosophie de la corrida repose sur une négation de l’altérité. Le taureau est « humanisé » pour pouvoir être mis sur la même échelle de valeurs que l’homme qui le combat – et permettre ainsi la comparaison, dans le seul but de pouvoir affirmer la supériorité humaine, qui n’aurait aucun mérite si l’adversaire ne partageait pas les mêmes « vertus cardinales ».
Wolff souligne également que la mise à mort s’accompagne d’un rituel expiatoire. Il dit ailleurs que cela revient à respecter le taureau comme un dieu. Raisonnement une fois de plus typiquement anthropocentrique : le taureau se moque bien d’être respecté comme un dieu s’il souffre et meurt dans l’arène. De la même manière, je ne peux pas justifier l’enlèvement et le meurtre sacrificiel d’une jeune vierge par le fait que la codification de la pratique manifesterait mon respect à son égard. Le fait d’avoir des règles, des rites, un déguisement et, éventuellement, un grand respect pour sa victime, n’excuse ni ne justifie en rien ce qu’on lui fait subir.
Si l’on pense que la corrida se justifie par ce plaisir que peuvent éprouver certains hommes à y assister, qu’on le dise franchement. Mais qu’on cesse de dissimuler derrière un écran de fumée métaphysique des raisons qui sont en réalité beaucoup plus brutes.